Publié le vendredi 19 juin 2015 – Édition Libération
Droit d’asile chez les fous
Propos sans appel : «Nous sommes dans l’antichambre de notre propre liquidation… On se rencontre moins, on piétine. Comment se mobiliser pour résister à cette machine infernale ? Qu’en est-il de la valeur humaine de la folie ?» Voilà un texte rédigé par l’Association culturelle du personnel de Saint-Alban, et distribué ces jours-ci, au cours des Rencontres annuelles de Saint-Alban. Sinistre télescopage ! Alors que sort le récit de Didier Daeninckx sur les années de guerre de l’hôpital psychiatrique Saint-Alban – où se mélangeaient alors résistants, poètes et fous -, les héritiers du lieu se disent aujourd’hui effondrés, abattus, et évoquent leur disparation.
Et pourtant… S’il reste un lieu psychiatrique marqué du sceau de l’histoire, c’est bien à Saint-Alban, dans cette ancienne forteresse perdue en Lozère, situé à 1 000 mètres dans le plateau de grès rouge du Gévaudan. Ce petit village a toujours vécu autour de son château féodal, racheté en 1821 par des religieuses, puis devenu hôpital pour femmes aliénées ; avec le temps, le lieu s’est agrandi pour abriter jusqu’à plus de 600 malades. C’est dans ce bout du monde, qu’ont atterri, le 6 janvier 1940, François Tosquelles et, quelques mois plus tard, Lucien Bonnafé. Le premier est un anarchiste espagnol rescapé de la guerre civile, l’autre un militant communiste, résistant proche des surréalistes. Tous deux sont psychiatres. Et tous deux seront à l’origine de ce qui sera la plus formidable aventure de la psychiatrie d’après-guerre : la psychothérapie institutionnelle.
Bonnafé et Tosquelles sont inséparables, couple magnifique, unique, où les divergences théoriques sont fortes, les tempéraments aussi, mais une amitié sans faille les unit. Il fallait voir ce duo, dans les années 90, pourtant vieux et malade, revenant comme chaque année dans les ruelles de Saint-Alban au cours des «Rencontres annuelles». Lucien Bonnafé a été formellement le directeur de Saint-Alban de 1941 à 1943, mais Bonnafé restait toujours un pas en arrière de François Tosquelles, qui fut par la suite le directeur pendant plus de vingt ans, extraordinaire clinicien à l’accent catalan impossible.
JARDINAGE, COUTURE ET TROC
Saint-Alban fut un miracle, une incroyable ouverture à l’autre, dans un des endroits les plus reculés – ou abrités – de France. C’était l’idée qu’il fallait soigner l’asile autant que les personnes qui le fréquentent. C’était l’idée que «sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c’est l’homme même qui disparaît». En 1941, François Tosquelles a beau n’avoir que 29 ans, il a un passé impressionnant de psychiatre qui a monté pendant les années de guerre civile des dispensaires sur le front, où il se servait des prostituées comme personnel soignant. Et quand il débarque à Saint-Alban, il n’a pas la tête dans les étoiles. Surgit une urgence : la faim. Dès 1940, apparaissent en effet des difficultés de ravitaillement. Et ce sont près de 2 000 personnes qu’il faut nourrir. Tosquelles ne se trompe pas d’urgence : toutes les valides sont mobilisés. Dans cette région agricole mais isolée, les malades vont alors sortir, assurer le jardinage, le ramassage de pommes de pin, de champignons. Des liens se créent. A l’intérieur de l’asile, les femmes font des travaux de couture, de filage et de tricotage pour les paysans du village : ils servent de troc contre des produits alimentaires introuvables, dont le beurre. Et ce n’est pas tout : les malades échangent la ration alcoolique qui leur est octroyée contre des pommes de terre. De ce fait, Saint-Alban est l’hôpital psychiatrique français qui a compté le moins de décès dus à la famine. En France, 40 000 malades mentaux sont morts de faim entre 1940 et 1944.
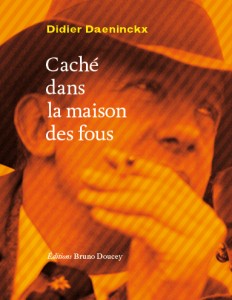 L’AUDACE OMNIPRÉSENTE
L’AUDACE OMNIPRÉSENTE
Et ce n’est pas tout. Saint-Alban va devenir un territoire où la folie se fait résistante. Lucien Bonnafé, lors d’une rencontre, dans les années 90 : «A Saint-Alban, Tosquelles habitait un étage, moi un autre, et on s’est constitués en société savante, on a appelé nos réunions, les réunions de la société du Gévaudan.» Tosquelles : «Nos réunions étaient presque permanentes, on avait beaucoup de temps, il fallait attendre souvent, par exemple, le parachutage ou l’arrivée d’un visiteur clandestin. Alors, on parlait de psychiatrie. Des rencontres presque journalières, ou nocturnes. On analysait ainsi l’hôpital psychiatrique, on disait, entre blague et sérieux, que c’était un marquisat, le territoire d’un marquis. La structure du médecin chef était celle du châtelain, avec les classes sociales étagées, les infirmiers, les malades.»
A cause de la guerre et de cet emplacement difficile d’accès, l’audace est alors omniprésente. «On a beaucoup travaillé avec les paysans, les gendarmes. Il y avait beaucoup de gendarmes qui avaient participé à la résistance, ne parlons pas de quelques curés, des instituteurs», racontait Tosquelles. Lieu unique. Des fous et des résistants. A Saint-Alban, on vit, on travaille, on dessine, on peint, on écrit, on se bat, et on discute sans fin, avec Eluard qui passe, Tristan Tzara aussi, ou encore le philosophe Canguilhem, comme le rappelle Didier Daeninckx dans son livre. Un moment de grâce, où tout peut être possible. Soixante-dix ans plus tard, la guerre est finie. Et Saint-Alban s’épuise.
Eric FAVEREAU – Libération
